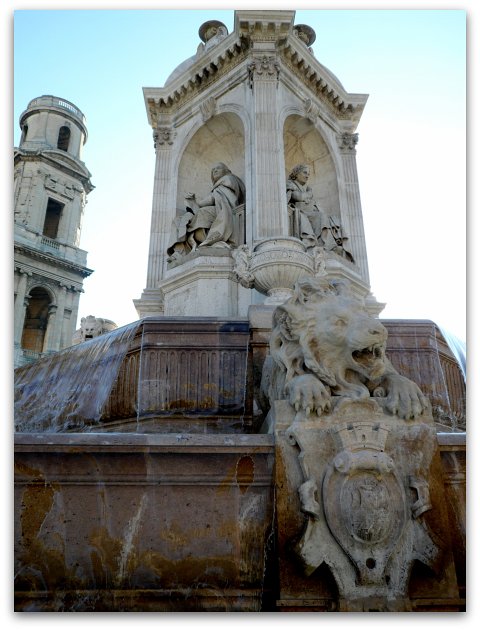On trouve au pied des monts Apalaches, dans les Florides, des fontaines qu’on appelle puits naturels. Chaque puits est creusé au centre d’un monticule planté d’orangers, de chênes-verts et de catalpas. Ce monticule s’ouvre en forme de croissant, du côté de la savane, et un courant d’eau sort du puits par cette ouverture. Les arbres, en s’inclinant sur la fontaine, rendent sa surface toute noire au-dessous ; mais à l’endroit où le courant d’eau s’échappe de la base du cône, un rayon du jour, pénétrant par le lit du canal, tombe sur un seul point du miroir de la fontaine, qui imite l’effet de la glace dans la chambre obscure du peintre. Cette charmante retraite est ordinairement habitée par un énorme crocodile, qui se tient immobile au milieu du bassin : à son écaille verdoyante, à ses larges naseaux qui lancent les ondes en deux ellipses colorées, vous le prendriez pour un dragon de bronze dans quelque grotte des bosquets de Versailles.
Les crocodiles ou caïmans des Florides ne vivent pas toujours solitaires. Dans certains temps de l’année ils s’assemblent en troupes, et se mettent en embuscade pour attaquer des voyageurs qui doivent arriver de l’Océan. Lorsque ceux-ci ont remonté les fleuves, que l’eau manque à leur multitude, qu’ils meurent échoués sur les rivages et menacent de répandre la peste dans l’air, la Providence les livre tout à coup à une armée de quatre ou cinq mille crocodiles. Les monstres, poussant un cri et faisant claquer leurs mâchoires, fondent sur les étrangers. Bondissant de toutes parts, les combattants se joignent, se saisissent, s’entrelacent. Ils se plongent au fond des gouffres, se roulent dans les limons, remontent à la surface de l’eau. Le fleuve taché de sang se couvre de corps mutilés et d’entrailles fumantes. Rien ne peut donner une idée de ces scènes extraordinaires, décrites par les voyageurs, et que le lecteur est toujours tenté de prendre pour de vaines exagérations.
Rompues, dispersées, pleines d’épouvante, les légions étrangères, poursuivies jusqu’à l’Océan, sont forcées de rentrer dans les abîmes, afin que, désormais utiles à nos besoins, elles nous servent sans nous nuire.
Ces espèces de monstres ont quelquefois révolté la sagesse de l’athée : ils sont pourtant nécessaires dans le plan général. Ils n’habitent que les déserts où l’absence de l’homme commande leur présence ; ils y sont placés pour détruire, jusqu’à l’arrivée du grand destructeur. Aussitôt que nous apparaissons sur une côte, ils nous cèdent l’empire, certains qu’un seul de nous fera plus de ravages que dix mille d’entre eux.
Et pourquoi Dieu fait-il des êtres superflus qui obligent ensuite à des destructions ? Par la raison que Dieu n’agit pas, comme nous, d’une manière bornée ; il se contente de dire : Croissez et multipliez ; et l’infini est dans ces deux mots. Dorénavant pour être sage il faudra peut-être que la Divinité soit médiocre ; l’infini sera un attribut que nous lui retrancherons ; tout ce qui sera immense sera rejeté. Nous dirons : "Cela est de trop dans la nature", parce que notre esprit ne pourra le comprendre. Et que si Dieu s’avise de placer plus d’un certain nombre de soleils dans la voûte céleste, nous tiendrons l’excédant comme non avenu, et, en conséquence de cette prodigalité d’univers, nous déclarerons le Créateur convaincu de folie et d’impuissance.
Considérés en eux-mêmes, quelle que soit la difformité de ces êtres que nous appelons des monstres, on peut encore reconnaître sous leurs horribles traits quelques marques de la bonté divine. Un crocodile, un serpent, ne sont pas moins tendres pour leurs petits qu’un rossignol, une colombe. C’est d’abord un contraste miraculeux et touchant de voir un crocodile bâtir un nid et pondre un œuf comme une poule, et un petit monstre sortir d’une coquille comme un poussin. La femelle du crocodile montre ensuite pour sa famille la plus tendre sollicitude. Elle se promène entre les nids de ses sœurs, qui forment des cônes d’œufs et d’argile, et qui sont rangés comme les tentes d’un camp au bord d’un fleuve. L’amazone fait une garde vigilante et laisse agir les feux du jour ; car si la délicate affection de la mère est comme représentée par l’œuf du crocodile, la force et les mœurs de ce puissant animal se peignent, pour ainsi dire, dans le soleil qui couve cet œuf et dans le limon qui lui sert de levain. Aussitôt qu’une des meules a germé, la femelle prend sous sa protection les monstres naissants : ce ne sont pas toujours ses propres fils ; mais elle fait par ce moyen l’apprentissage de la maternité, et rend son habileté égale à ce que sera sa tendresse. Quand enfin sa famille vient à éclore, elle la conduit au fleuve, la lave dans une eau pure, lui apprend à nager, pêche pour elle de petits poissons, et la protège contre les mâles qui veulent souvent la dévorer.
Un Espagnol des Florides nous a conté qu’ayant enlevé la couvée d’un crocodile, et la faisant emporter dans un panier par des nègres, la femelle le suivit avec des cris pitoyables. On posa deux des petits à terre : la mère aussitôt se mit à les pousser avec ses mains et son museau, tantôt se tenant derrière eux pour les défendre, tantôt marchant à leur tête pour leur montrer le chemin. Les petits se traînaient, en gémissant, sur les traces de leur mère, et ce reptile énorme, qui naguère ébranlait le rivage de ses rugissements, faisait alors entendre une sorte de bêlement aussi doux que celui d’une chèvre qui allaite ses chevreaux.
Le serpent à sonnettes le dispute au crocodile en affection maternelle : ce reptile, qui donne aux hommes des leçons de générosité, leur en donne encore de tendresse. Quand sa famille est poursuivie, il la reçoit dans sa gueule : peu content des lieux où il la pourrait cacher, il la fait rentrer en lui, ne trouvant point pour des enfants d’asile plus sûr que le sein d’une mère. Exemple d’un dévouement sublime, il ne survit point à la perte de ses petits, car pour les lui ravir il faut les arracher de ses entrailles.
Parlerons-nous du poison de ce serpent, toujours plus violent au temps où il a une famille ? Raconterons-nous la tendresse de l’ours, qui, semblable à la femme sauvage, pousse l’amour maternel jusqu’à allaiter ses enfants après leur mort ?
Qu’on suive ces prétendus monstres dans leurs instincts ; qu’on étudie leurs formes, leurs armures ; qu’on fasse attention à l’anneau qu’ils occupent dans la chaîne de la création ; qu’on les examine dans leurs propres rapports et dans ceux qu’ils ont avec l’homme, nous osons assurer que les causes finales sont peut-être plus visibles dans cette classe d’êtres qu’elles ne le sont dans les espèces plus favorisées de la nature, de même que dans un ouvrage barbare les traits de génie brillent davantage au milieu des ombres qui les environnent.
L’objection que l’on fait contre les lieux que ces monstres habitent ne nous paraît pas mieux fondée. Les marais, tout nuisibles qu’ils semblent, ont cependant de grandes utilités. Ce sont les urnes des fleuves dans les pays de plaines, et les réservoirs des pluies dans les contrées éloignées de la mer. Leur limon et les cendres de leurs herbes fournissent des engrais aux laboureurs ; leurs roseaux donnent le feu et le toit à de pauvres familles ; frêle couverture, en harmonie avec la vie de l’homme, et qui ne dure pas plus que nos jours.
Ces lieux ont même une certaine beauté qui leur est propre : frontière de la terre et de l’eau, ils ont des végétaux, des sites et des habitants particuliers : tout y participe du mélange des deux éléments. Les glaïeuls tiennent le milieu entre l’herbe et l’arbuste, entre le poireau des mers et la plante terrestre ; quelques-uns des insectes fluviatiles ressemblent à de petits oiseaux : quand la demoiselle, avec son corsage bleu et ses ailes transparentes, se repose sur la fleur du nénuphar blanc, on croirait voir l’oiseau-mouche des Florides sur une rose de magnolia. En automne, ces marais sont plantés de joncs desséchés, qui donnent à la stérilité même l’air des plus opulentes moissons ; au printemps, ils présentent des bataillons de lances verdoyantes. Un bouleau, un saule isolé où la brise a suspendu quelques flocons de plumes, domine ces mouvantes campagnes ; le vent glissant sur ces roseaux incline tour à tour leurs cimes : l’une s’abaisse, tandis que l’autre se relève ; puis soudain, toute la forêt venant à se courber à la fois, on découvre ou le butor doré, ou le héron blanc, qui se tient immobile sur une longue patte comme sur un épieu.
CHATEAUBRIAND, Génie du Christianisme ; Première Partie - Dogmes et doctrines ; Livre 5 - Existence de Dieu prouvée par les merveilles de la nature ; Chapitre X - Amphibies et reptiles