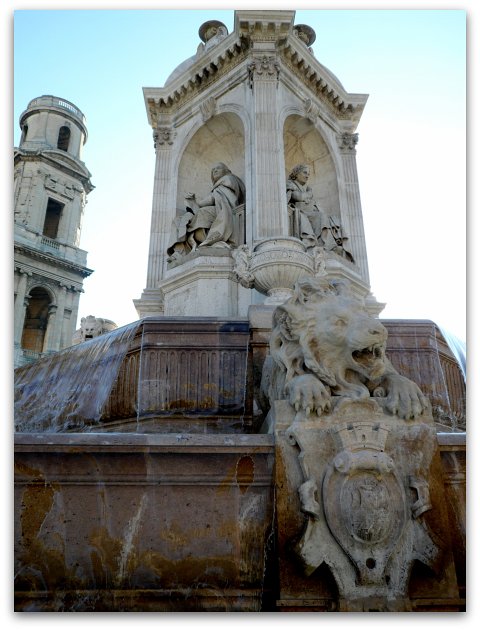Il y avait un homme qui à douze ans avec des barres et des ronds, avait créé les mathématiques ; qui à seize avait fait le plus savant traité des coniques qu’on eût vu depuis l’antiquité ; qui à dix-neuf réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l’entendement ; qui à vingt-trois ans démontra les phénomènes de la pesanteur de l’air, et détruisit une des grandes erreurs de l’ancienne physique ; qui à cet âge où les autres hommes commencent à peine de naître, ayant achevé de parcourir le cercle des sciences humaines, s’aperçut de leur néant, et tourna ses pensées vers la religion ; qui depuis ce moment jusqu’à sa mort, arrivée dans sa trente-neuvième année, toujours infirme et souffrant, fixa la langue que parlèrent Bossuet et Racine, donna le modèle de la plus parfaite plaisanterie comme du raisonnement le plus fort ; enfin, qui, dans les courts intervalles de ses maux, résolut par abstraction un des plus hauts problèmes de géométrie et jeta sur le papier des pensées qui tiennent autant du dieu que de l’homme : cet effrayant génie se nommait Blaise Pascal.
Il est difficile de ne pas rester confondu d’étonnement lorsqu’en ouvrant les Pensées du philosophe chrétien on tombe sur les six chapitres où il traite de la nature de l’homme. Les sentiments de Pascal sont remarquables surtout par la profondeur de leur tristesse et par je ne sais quelle immensité : on est suspendu au milieu de ces sentiments comme l’infini. Les métaphysiciens parlent de cette pensée abstraite qui n’a aucune propriété de la matière, qui touche à tout sans se déplacer, qui vit d’elle-même, qui ne peut périr parce qu’elle est invisible, et qui prouve péremptoirement l’immortalité de l’âme : cette définition de la pensée semble avoir été suggérée aux métaphysiciens par les écrits de Pascal.
Il y a un monument curieux de la philosophie chrétienne et de la philosophie du jour : ce sont les Pensées de Pascal commentées par les éditeurs. On croit voir les ruines de Palmyre, restes superbes du génie et du temps, au pied desquelles l’Arabe du désert a bâti sa misérable hutte.
Voltaire a dit : " Pascal, fou sublime, né un siècle trop tôt."
On entend ce que signifie ce siècle trop tôt.
Une seule observation suffira pour faire voir combien Pascal sophiste eût été inférieur à Pascal chrétien.
Dans quelle partie de ses écrits le solitaire de Port-Royal s’est-il élevé au-dessus des plus grands génies ? Dans ses six chapitres sur l’homme. Or, ces six chapitres, qui roulent entièrement sur la chute originelle, n’existeraient pas si Pascal eût été incrédule.
Il faut placer ici une observation importante. Parmi les personnes qui ont embrassé les opinions philosophiques, les unes ne cessent de décrier le siècle de Louis XIV ; les autres, se piquant d’impartialité, accordent à ce siècle les dons de l’imagination et lui refusent les facultés de la pensée. C’est le dix-huitième siècle, s’écrie-t-on, qui est le siècle penseur par excellence.
Un homme impartial qui lira attentivement les écrivains du siècle de Louis XIV s’apercevra bientôt que rien n’a échappé à leur vue, mais que, contemplant les objets de plus haut que nous, ils ont dédaigné les routes où nous sommes entrés, et au bout desquelles leur œil perçant avait découvert un abîme.
Nous pouvons appuyer cette assertion de mille preuves. Est-ce faute d’avoir connu les objections contre la religion que tant de grands hommes ont été religieux ? Oublie-t-on que Bayle publiait à cette époque même ses doutes et ses sophismes ? Ne sait-on plus que Clarke et Leibnitz n’étaient occupés qu’à combattre l’incrédulité ; que Pascal voulait défendre la religion ; que La Bruyère faisait son chapitre des Esprits forts et Massillon son sermon de la Vérité d’un avenir ; que Bossuet, enfin, lançait ces paroles foudroyantes sur les athées :
" Qu’ont-ils vu, ces rares génies, qu’ont-ils vu plus que les autres ? Quelle ignorance est la leur, et qu’il serait aisé de les confondre, si, faibles et présomptueux, ils ne craignaient point d’être instruits ! car pensent-ils avoir vu mieux les difficultés à cause qu’ils y succombent, et que les autres qui les ont vues les ont méprisées ? Ils n’ont rien vu, ils n’entendent rien, ils n’ont pas même de quoi établir le néant auquel ils espèrent après cette vie, et ce misérable partage ne leur est pas assuré."
Et quels rapports moraux, politiques ou religieux se sont dérobés à Pascal ? quel côté de choses n’a-t-il point saisi ? S’il considère la nature humaine en général, il en fait cette peinture si connue et si étonnante : "La première chose qui s’offre à l’homme quand il se regarde, c’est son corps, etc." Et ailleurs : "L’homme n’est qu’un roseau pensant, etc." Nous demandons si dans tout cela Pascal s’est montré un faible penseur ?
Les écrivains modernes se sont fort étendus sur la puissance de l’opinion, et c’est Pascal qui le premier l’avait observée. Une des choses les plus fortes que Rousseau ait hasardées en politique se lit dans le Discours sur l’inégalité des conditions : "Le premier, dit-il, qui, ayant clos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, fut le vrai fondateur de la société civile". Or, c’est presque mot pour mot l’effrayante idée que le solitaire de Port-Royal exprime avec une tout autre énergie : "Ce chien est à moi, disaient ces pauvres enfants ; c’est ma place au soleil : voilà le commencement et l’image de l’usurpation de toute la terre."
Et voilà une de ces pensées qui font trembler pour Pascal. Quel ne fût point devenu ce grand homme s’il n’avait été chrétien ! Quel frein adorable que cette religion qui, sans nous empêcher de jeter de vastes regards autour de nous, nous empêche de nous précipiter dans le gouffre !
C’est le même Pascal qui a dit encore : " Trois degrés d’élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité ou de peu d’années de possession. Les lois fondamentales changent, le droit a ses époques ; plaisante justice qu’une rivière ou une montagne borne ; vérité au deçà des Pyrénées, erreur au delà."
Certes, le penseur le plus hardi de ce siècle, l’écrivain le plus déterminé à généraliser les idées pour bouleverser le monde, n’a rien dit d’aussi fort contre la justice des gouvernements et les préjugés des nations.
Les insultes que nous avons prodiguées par philosophie à la nature humaine ont été plus ou moins puisées dans les écrits de Pascal. Mais en dérobant à ce rare génie la misère de l’homme nous n’avons pas su comme lui en apercevoir la grandeur. Bossuet et Fénelon, le premier dans son Histoire universelle, dans ses Avertissements et dans sa Politique tirée de l’Écriture sainte, le second dans son Télémaque, ont dit sur les gouvernements toutes les choses essentielles. Montesquieu lui-même n’a souvent fait que développer les principes de l’évêque de Meaux, comme on l’a très bien remarqué. On pourrait faire des volumes des divers passages favorables à la liberté et à l’amour de la patrie qui se trouvent dans les auteurs du dix-septième siècle.
Et que n’a-t-on point tenté dans ce siècle ? L’égalité des poids et mesures, l’abolition des coutumes provinciales, la réformation du Code civil et criminel, la répartition égale de l’impôt : tous ces projets dont nous nous vantons ont été proposés, examinés, exécutés même quand les avantages de la réforme en ont paru balancer les inconvénients. Bossuet n’a-t-il pas été jusqu’à vouloir réunir l’Église protestante à l’Église romaine ? Quand on songe que Bagnoli, Le Maître, Arnauld, Nicole, Pascal s’étaient consacrés à l’éducation de la jeunesse, on aura de la peine à croire sans doute que cette éducation est plus belle et plus savante de nos jours. Les meilleurs livres classiques que nous ayons sont encore ceux de Port-Royal, et nous ne faisons que les répéter, souvent en cachant nos larcins dans nos ouvrages élémentaires.
Notre supériorité se réduit donc à quelques progrès dans les études naturelles ; progrès qui appartiennent à la marche du temps, et qui ne compensent pas, à beaucoup près, la perte de l’imagination qui en est la suite. La Pensée est la même dans tous les siècles, mais elle est accompagnée plus particulièrement ou des arts ou des sciences ; elle n’a toute sa grandeur poétique et toute sa beauté morale qu’avec les premiers.
Mais si le siècle de Louis XIV a conçu les idées libérales, pourquoi donc n’en a-t-il pas fait le même usage que nous ? Certes, ne nous vantons pas de notre essai. Pascal, Bossuet, Fénelon, ont vu plus loin que nous, puisqu’en connaissant comme nous, et mieux que nous, la nature des choses, ils ont senti le danger des innovations. Quand leurs ouvrages ne prouveraient pas qu’ils ont eu des idées philosophiques, pourrait-on croire que ces grands hommes n’ont pas été frappés des abus qui se glissent partout et qu’ils ne connaissaient pas le faible et le fort des affaires humaines ? Mais tel était leur principe, qu’il ne faut pas faire un petit mal, même pour obtenir un grand bien, à plus forte raison pour des systèmes dont le résultat est presque toujours effroyable. Ce n’était pas par défaut de génie sans doute que ce Pascal, qui, comme nous l’avons montré, connaissait si bien le vice des lois dans le sens absolu, disait dans le sens relatif : "Que l’on a bien fait de distinguer les hommes par les qualités extérieures ! Qui passera de nous deux ? Qui cédera la place à l’autre ? Le moins habile ? Mais je suis aussi habile que lui : il faudra se battre pour cela. Il a quatre laquais, et je n’en ai qu’un ; cela est visible, il n’y a qu’à compter : c’est à moi à céder, et je suis un sot si je le conteste." Cela répond à des volumes de sophismes. L’auteur des Pensées, se soumettant aux quatre laquais, est bien autrement philosophe que ces penseurs que les quatre laquais ont révoltés.
En un mot, le siècle de Louis XIV est resté paisible, non parce qu’il n’a point aperçu telle ou telle chose, mais parce qu’en la voyant il l’a pénétrée jusqu’au fond ; parce qu’il en a considéré toutes les faces et connu tous les périls. S’il ne s’est point plongé dans les idées du jour, c’est qu’il leur a été supérieur : nous prenons sa puissance pour sa faiblesse ; son secret et le nôtre sont renfermés dans cette pensée de Pascal :
" Les sciences ont deux extrémités qui se touchent : la première est la pure ignorance naturelle où se trouvent les hommes en naissant ; l’autre extrémité est celle où arrivent les grandes âmes, qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu’ils ne savent rien et se rencontrent dans cette même ignorance d’où ils sont partis ; mais c’est une ignorance savante qui se connaît. Ceux d’entre eux qui sont sortis de l’ignorance naturelle et n’ont pu arriver à l’autre ont quelque teinture de cette science suffisante, et font les entendus. Ceux-là troublent le monde et jugent plus mal que tous les autres. Le peuple et les habiles composent pour l’ordinaire le train du monde ; les autres les méprisent et en sont méprisés."
Nous ne pouvons nous empêcher de faire ici un triste retour sur nous-même. Pascal avait entrepris de donner au monde l’ouvrage dont nous publions aujourd’hui une si petite et si faible partie. Quel chef-d’œuvre ne serait point sorti des mains d’un tel maître ! Si Dieu ne lui a pas permis d’exécuter son dessein, c’est qu’apparemment il n’est pas bon que certains doutes sur la foi soient éclaircis, afin qu’il reste matière à ces tentations et à ces épreuves qui font les saints et les martyrs.
CHATEAUBRIAND, Génie du Christianisme, Troisième Partie, Beaux-arts et Littérature, Livre 2, Philosophie, Chapitre VI - Suite des Moralistes